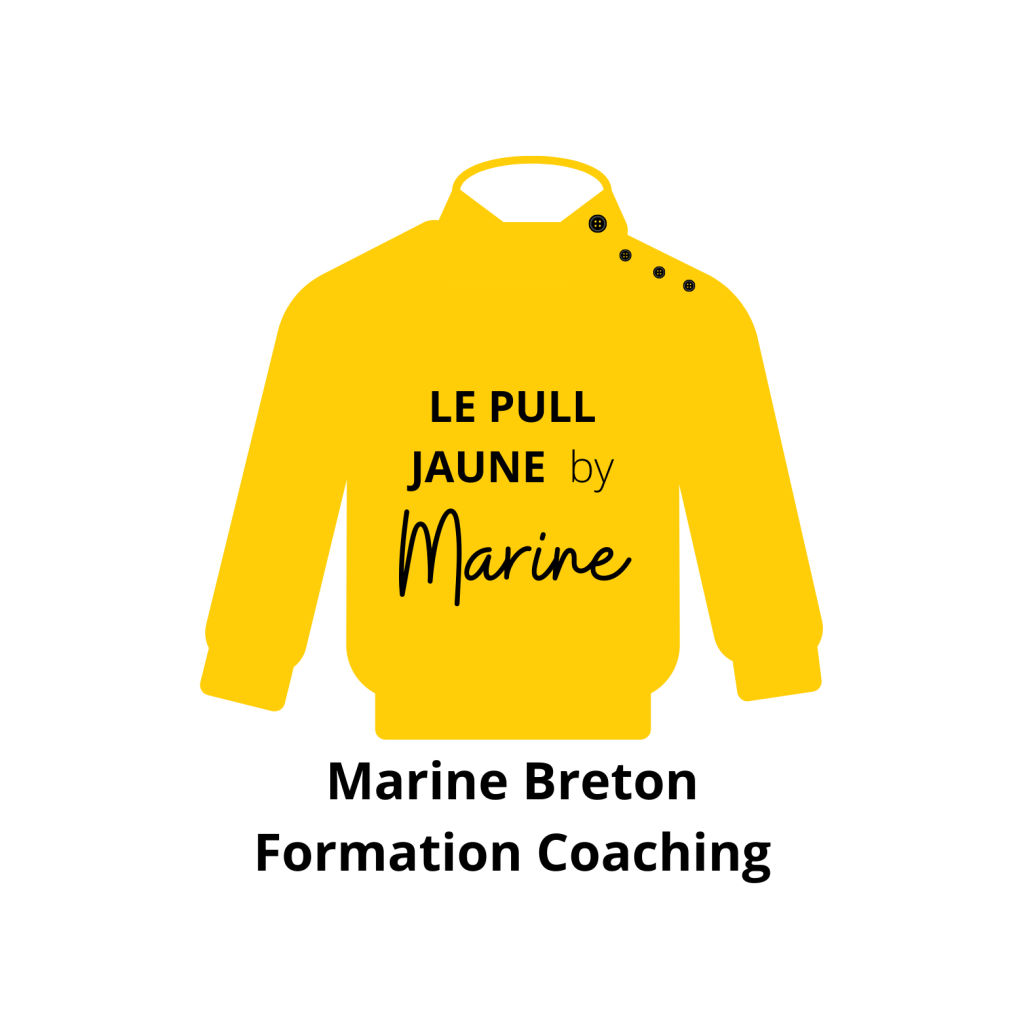Pourquoi nos réponses tournent souvent en rond — et comment la Questiologie en sort
Une étrange sensation de déjà-vu
Il vous est déjà arrivé de poser une question… et d’obtenir toujours le même type de réponse ? Ou d’animer une réunion, où les idées tournent en boucle, sans jamais vraiment faire un pas de côté ?
C’est ce que vivent de nombreuses équipes. Pas par manque d’intelligence. Pas par paresse. Mais parce que leurs schémas de pensée sont figés dans une boucle. Une boucle de réponses prévisibles, conditionnées par des années d’habitudes mentales, de réflexes organisationnels, de conformisme discret.
C’est là que la Questiologie entre en scène.
La boucle des réponses conditionnées
Avant d’entrer dans le vif du sujet, posons le décor.
Quand une question est posée dans un cadre professionnel, elle obéit souvent à des règles implicites :
* Il faut aller vite
* Il faut trouver une solution
* Il faut avoir l’air compétent
Ces trois « il faut » produisent un effet collatéral : on répond sans vraiment réfléchir. On pioche dans ce qu’on connaît déjà. On répète ce qui a déjà été dit. On cherche une réponse qui sera acceptée, pas forcément celle qui bouscule ou qui ouvre.
Résultat ?
Des réunions où l’on s’écoute poliment, mais où rien ne se transforme vraiment.
La Questiologie : une invitation à sortir du cadre
La Questiologie ne cherche pas à répondre. Elle cherche à questionner autrement.
Cette discipline, encore méconnue, s’appuie sur une conviction forte : les réponses ne sont que le reflet des questions que l’on ose — ou non — poser.
Changer de question, c’est ouvrir un nouvel espace de pensée.
Prenons un exemple concret. Une équipe se plaint d’un manque d’engagement. La question posée est souvent :
« Comment faire pour que les collaborateurs soient plus motivés ? »
Sous-entendu : la faute vient d’eux. Ce qui oriente les réponses vers des solutions de type incentive, récompenses, ou communication interne.
Mais si l’on reformule ainsi :
« Qu’est-ce que notre fonctionnement collectif dit de notre vision de la motivation ? »
Ou encore :
« Et si l’ennui était un signal utile ? Que nous raconte-t-il ? »
Alors, l’espace s’ouvre. Les réponses ne sont plus automatiques. Elles deviennent co-construites, imprévisibles, vivantes.
Trois verrous qui nous enferment dans des réponses stériles
En formation, j’identifie souvent trois mécanismes qui empêchent les équipes de sortir de leurs schémas mentaux :
1. Le réflexe solutionniste
C’est le plus répandu. Une problématique apparaît ? Il faut la résoudre. Vite. Même si elle est mal posée. Résultat : on traite les symptômes, jamais les causes.
2. L’obsession du consensus
Très française. La peur de déranger, de paraître trop clivant, amène à édulcorer les vraies questions. Or, une bonne question dérange toujours un peu.
3. Le confort des certitudes
On valorise beaucoup l’expertise. Mais l’expert, s’il n’y prend garde, peut devenir prisonnier de son savoir. Il répond trop vite. Il sait. Il ne doute plus.
La puissance d’un questionnement vivant
En Questiologie, nous ne cherchons pas la « bonne » question. Nous cherchons une question vivante.
C’est-à-dire une question qui :
* Crée un silence fertile
* Invite à la curiosité
* Ne demande pas de réponse immédiate
* Fait émerger plusieurs niveaux de lecture
Une telle question peut transformer une réunion entière. Elle ralentit le rythme, redonne de l’espace à la pensée, fait émerger des angles morts… et parfois, change complètement la perspective.
Pour conclure : et si vous arrêtiez (un peu) de chercher des réponses ?
Dans un monde obsédé par l’efficacité, la Questiologie fait un pas de côté salutaire. Elle ne nie pas l’importance de décider, de trancher, d’agir. Mais elle rappelle ceci : sans questionnement sincère, nos décisions sont souvent des redites.
Alors, la prochaine fois que vous animerez une réunion, posez-vous cette simple question :
Suis-je en train d’inviter à penser, ou simplement à répondre ?
Et observez ce que cela change.
________________
Marine Breton, Directrice d’un organisme de formation, Maître Praticienne en Questiologie©